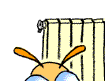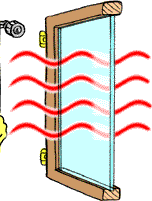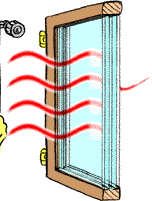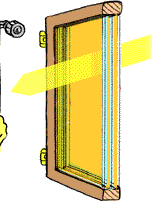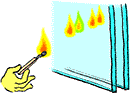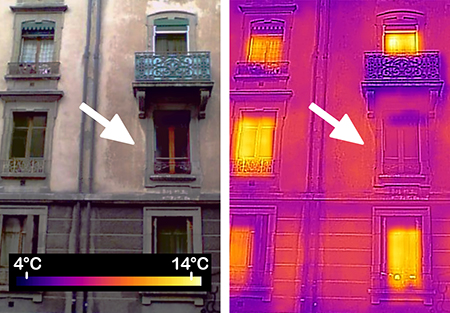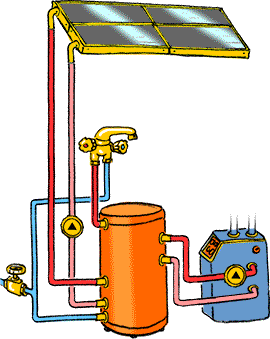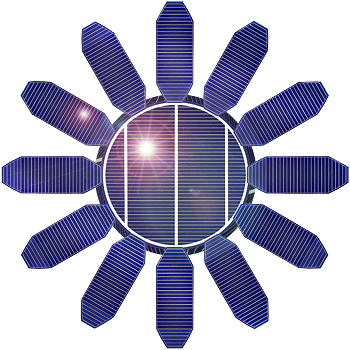
Le prix des panneaux solaires photovoltaïques a tellement baissé que le kilowattheure d’électricité solaire produit sur son toit peut revenir moins cher que le kilowattheure vendu par son distributeur. De plus, le marché propose des nouveautés, tels les capteurs solaires "hybrides" (qui combinent la production d’électricité et de chaleur) ou les grandes batteries de stockage à haute performance qui augmentent l’autonomie d’un bâtiment. Il faut encore ajouter que les pompes à chaleur électriques sont devenues très performantes pour chauffer un bâtiment et son eau sanitaire, ou pour récupérer la chaleur d’une évacuation de ventilation. Voilà pourquoi il est utile de parler "énergie du bâtiment" au sens large, lorsqu’on s’intéresse a priori uniquement à l’électricité solaire.
Profiter de l'énergie solaire
Types d'installations
1100 kWh d’énergie solaire par m2 et par an
En Suisse, le soleil délivre annuellement sur chaque mètre carré une quantité d’énergie comprise entre 1000 kWh (en plaine, au nord du pays) et 1500 kWh (en altitude) – pour autant que ce mètre carré ne soit pas à l’ombre des montagnes, des arbres ni des constructions. En moyenne, on peut compter chaque année sur 1100 kWh, soit l’équivalent de 100 litres de mazout, ou de 100 m3 de gaz naturel, ou de 200 kg de pellets de bois. Mais encore faut-il parvenir à capter et à valoriser cette énergie renouvelable. Dans le secteur du bâtiment, il y a surtout quatre moyens d’en profiter :
- De manière passive, grâce à une architecture qui facilite non seulement la pénétration directe du soleil par les fenêtres en hiver (mais pas en été), mais aussi le stockage de la chaleur solaire dans la masse des murs et des dalles (voir sources de chaleur passives).
- Avec des capteurs solaires thermiques. Le but est de collecter de la chaleur dans un accumulateur d’eau pour produire de l’eau chaude sanitaire (toute l’année). Avec une plus grande surface de capteurs et un accumulateur d’eau plus volumineux, il est possible de participer aussi au chauffage durant la saison froide. Si l’appoint de chauffage est assuré par une pompe à chaleur "sol-eau" couplée à des sondes géothermiques, on peut même profiter de la belle saison pour conduire la chaleur solaire en profondeur dans le sol, afin de compenser la chaleur soutirée en hiver – ce qui permet d’utiliser des sondes moins profondes et moins coûteuses.
- Avec des panneaux solaires photovoltaïques (producteurs d’électricité) :
- Pour injecter toute l’électricité dans le réseau public.
- Pour consommer une partie de l’électricité dans le bâtiment (autoconsommation).
- Pour partager une même installation solaire entre plusieurs ménages (communauté d'autoconsommateurs).
- Pour produire de l’eau chaude avec un chauffe-eau "pompe à chaleur" (CEPAC).
- Pour produire du chauffage et de l’eau chaude avec une pompe à chaleur.
- Pour rafraîchir les locaux en été.
- Pour électrifier un bâtiment qui n’est pas relié au réseau public.
- Avec des panneaux photovoltaïques-thermiques (panneaux "hybrides") qui produisent à la fois de l’électricité et de la chaleur.
- Avec une petite installation photovoltaïque Plug & Play mobile branchée directement sur une prise électrique.
Puissance installée
Les watts-crête (Wc) définissent une installation photovoltaïque
Les panneaux solaires photovoltaïques fonctionnent grâce à des matériaux semi-conducteurs qui convertissent une partie du rayonnement du soleil en électricité (les LED d’éclairage, constituées du même genre de matériaux, font exactement le contraire en convertissant l’électricité en lumière). Les panneaux font cette conversion avec des rendements qui vont de 10 à 21% au maximum. Ils sont généralement assemblés en groupe, reliés par des câbles à plusieurs dispositifs qui gèrent leur électricité afin de la stocker dans des batteries ou de la rendre compatible avec l’électricité du réseau.

Pour définir une installation photovoltaïque, on ne parle pas de sa surface mais de sa puissance en watt-crête (Wc ou, en anglais, Wp = Watt-peak), à savoir la puissance électrique qu’un ensemble de panneaux peut délivrer dans des conditions standardisées d’ensoleillement: les panneaux reçoivent perpendiculairement un rayonnement solaire d’une puissance de 1000 W/m2, et ils sont à une température de 25°C (ils ne sont pas échauffés par le rayonnement solaire). Ainsi, pour atteindre une même puissance de crête, des panneaux solaires avec une efficacité de 20% occupent deux fois moins de place que des panneaux avec une efficacité de 10%.
Dans la réalité, les conditions nécessaires à atteindre la puissance de crête sont rarement réunies: le ciel est souvent nuageux, l’angle d’arrivée du soleil sur les panneaux varie dans la journée et au fil de saison, et la température des panneaux s’élève sous l’effet du rayonnement solaire – ce qui diminue leur rendement. D’autant que des pertes dans le câblage et les dispositifs qui gèrent l’électricité réduisent la performance générale.
Sur le Plateau suisse, pour couvrir la consommation d’électricité annuelle d’un ménage standard – soit environ 3500 kWh – une installation de 4 kWc (4 kilowatts-crête) peut suffire. On peut, par exemple, les atteindre avec 20 m2 de panneaux en silicium monocristallin (rendement 20%) orientés vers le sud et inclinés à 35°. Si ces panneaux sont placés sur la façade, il en faut 30 m2. Et si le pan du toit regarde vers le sud-est ou le sud-ouest, il en faut 24 m2. Lorsque le toit est plat, les panneaux sont généralement disposés en rangs inclinés vers le soleil et suffisamment espacés pour ne pas se faire mutuellement de l’ombre. Ils prennent alors plus du double de surface que s’ils sont juxtaposés sur un toit en pente.
Ceci-dit, lorsqu'on dit qu'une installation photovoltaïque "couvre" la consommation électrique annuelle d'un bâtiment, cela ne veut pas dire que le bâtiment soit autonome en électricité. La production d'électricité solaire est faible en hiver, période où les besoins en électricité sont souvent les plus importants. D'où l'intérêt d'installer la plus grande surface de panneaux photovoltaïques possible.
Cadastre solaire
Consulter le cadastre solaire et faire une simulation avec un calculateur solaire

De nombreux cantons et communes disposent d’un cadastre solaire, à savoir d’une carte (généralement disponible sur internet) sur laquelle on peut voir quelles toitures sont les plus favorables à capter le soleil. La carte tient compte de l’orientation des pans de toit ainsi que des ombres portées par les montagnes, les arbres et les autres bâtiments. Cependant ces données restent indicatives: seul un examen du bâtiment sur place peut vraiment définir son potentiel solaire.
Par ailleurs, un calculateur solaire permet de se faire une idée de la taille, des performances et des coûts d’une installation solaire, en fonction du lieu d’implantation du bâtiment et de son orientation face au soleil. Mais l’ensoleillement du toit reste théorique: il ne tient généralement pas compte de l’environnement direct du bâtiment, comme c’est le cas d’un cadastre solaire.
Emplacement des panneaux solaires
Une installation photovoltaïque peut être isolée, rapportée (ajoutée) ou intégrée
Une installation photovoltaïque peut être isolée, c’est-à-dire posée sur le sol. Mais étant donné qu’en Suisse le terrain est rare, les panneaux solaires trouvent mieux leur place sur les toits et les façades des bâtiments, ainsi que sur les ouvrages d’art (ponts, murs de soutènement, murs-antibruit autoroutiers, etc). Sur un bâtiment, les capteurs peuvent être soit rapportés (on dit aussi ajoutés), c’est-à-dire fixés par-dessus un toit ou une façade, soit intégrés, c’est-à-dire qu’ils remplissent aussi une fonction architecturale: ils remplacent la couverture du toit, les panneaux de protection de façade ou les barrières de balcon. Cette distinction est importante pour le calcul de la rentabilité économique de l’installation solaire et pour le montant d’une éventuelle subvention. Si on doit rénover un toit en pente, il faut envisager l’intégration en priorité car la durée de vie des panneaux peut dépasser 30 ans. Pour un toit plat, il est également recommandé de coordonner la pose de l’installation solaire avec la réfection de l’étanchéité (les deux ont une durée de vie estimée à 30 ans ou plus).






www.solarchitecture.ch, exemples de bâtiments avec des panneaux solaires intégrés à l'architecture
Rentabilité
La rentabilité d’une installation solaire photovoltaïque
Une installation photovoltaïque privée est le plus souvent raccordée à un réseau électrique public, afin de lui revendre tout ou partie de son électricité solaire. Pour un profane, prévoir la rentabilité économique de sa future installation est un exercice compliqué. Il y a les coûts de mise en place: matériel et main d’oeuvre. Les coût de maintenance: contrôle, entretien et assurance (si elle n’est pas comprise dans l’assurance bâtiment). Les éventuelles subventions et les déductions fiscales: de Pronovo (SRI et RU), du canton et de la commune. Et il faut estimer la quantité d’électricité que les panneaux solaires vont engendrer au cours des années et qui sera revendue au réseau public.
Dans le calcul de rentabilité, on doit aussi tenir compte du courant que le bâtiment va lui-même économiser s’il profite directement de cette électricité solaire (autoconsommation) – ce qui est généralement souhaitable. Or, la performance des panneaux solaires dépend de leur technologie de fabrication, de l’ensoleillement et du climat du lieu où ils sont implantés, de leur orientation face au soleil, de l’ombrage (montagnes, arbres et bâtiments voisins). Sans oublier les pertes induites par le câblage, les dispositifs électriques et l’onduleur – le boîtier qui transforme l’électricité solaire (courant continu) en électricité compatible avec nos prises (courant alternatif). Il faut encore prendre en compte la baisse de production due au vieillissement de l’installation: de 0,5 à 0,8% par année suivant la technologie. Et les imprévus: des arbres qui grandissent, de nouvelles constructions qui s’installent, ou des étages qu’on rajoute aux bâtiments voisins. Ces nouveaux obstacles à la lumière solaire peuvent réduire la production électrique d’une proportion bien plus grande que la part d’ombre qu’ils portent sur les panneaux solaires.
Il est aussi très important que les panneaux soient ventilés par dessous. Au fur et à mesure qu’ils s’échauffent sous le soleil, leur rendement baisse: lorsque leur température dépasse 25°C, ils perdent en moyenne 0,4% de rendement pour chaque degré supplémentaire – et ils peuvent s’échauffer juqu’à 100°C !
Sur le site du service de l’énergie de son canton, ainsi que sur le site de Swissolar, on trouve des informations et des feuilles de calcul Excel pour faire ces estimations. Voir aussi sur le site web de son distributeur d’électricité: certains offrent leurs services pour deviser, installer et suivre l’installation au fil des ans. La plupart des installateurs de panneaux solaires offrent aussi un service complet – de la recherche de subvention à la mise en service. Étant donné les rapides évolutions du marché, il vaut la peine de comparer plusieurs offres comprenant un calcul de rentabilité.
Si on a une grande surface de toit à disposition, par exemple une ferme ou un hangar agricole, on peut même la louer à une société qui prendra en charge l’ensemble des coûts d’installation et de maintenance (contracting). De telles opérations sont aussi possibles pour réduire les coûts liés à la rénovation ou l’isolation d’un toit. Il est important que le contrat traite tous les cas de conflits possibles, notamment les fuites d’eau à travers les capteurs qui pourraient endommager le bâtiment.
Types de panneaux
Les différents panneaux solaires photovoltaïques
La technologie solaire évolue vite. Les performances des panneaux photovoltaïques s’améliorent en même temps que leur prix baisse. Le marché propose aussi régulièrement de nouveaux types de capteurs plus performants, plus minces, plus souples ou translucides. On peut les diviser en quatre familles :
 Panneau avec cellules en silicium monocristallin : cellules carrées aux coins arrondis encadrées sous verre, aspect bleu uni ou noir, rendement 16 à 21%, peut être utilisé comme couverture translucide (auvent, toiture de garage).
Panneau avec cellules en silicium monocristallin : cellules carrées aux coins arrondis encadrées sous verre, aspect bleu uni ou noir, rendement 16 à 21%, peut être utilisé comme couverture translucide (auvent, toiture de garage).
 Panneau avec cellules en silicium polycristallin : cellules juxtaposées sans jour, à l’aspect scintillant (dû à l’amalgame de cristaux orientés en tout sens) et encadrées sous verre, rendement 15-17%, plus sensible à la couverture nuageuse et à la chaleur qu’un panneau monocristallin.
Panneau avec cellules en silicium polycristallin : cellules juxtaposées sans jour, à l’aspect scintillant (dû à l’amalgame de cristaux orientés en tout sens) et encadrées sous verre, rendement 15-17%, plus sensible à la couverture nuageuse et à la chaleur qu’un panneau monocristallin.
 Panneau avec cellules en couche-mince ou en silicium amorphe : aspect foncé et uniforme (comme les cellules de calculette), rendement 6-14%, nombreuses technologies en plein développement, très mince ou souple, moins sensible aux températures élevées, certains ont une nette baisse de performance au cours des 1-2 premières années mais qui se stabilise par la suite.
Panneau avec cellules en couche-mince ou en silicium amorphe : aspect foncé et uniforme (comme les cellules de calculette), rendement 6-14%, nombreuses technologies en plein développement, très mince ou souple, moins sensible aux températures élevées, certains ont une nette baisse de performance au cours des 1-2 premières années mais qui se stabilise par la suite.
 Panneau solaire hybride "photovoltaïque-thermique" : un panneau solaire photovoltaïque a une production optimale d’électricité lorsque sa température est à environ 20°C. Or, il s’échauffe sous le soleil et perd de son efficacité. D’où l’idée de l’associer à un capteur solaire thermique non vitré: sous les cellules photovoltaïques est disposé un circuit d’eau qui récupère la chaleur (qui peut être utilisée pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, la régénération de la chaleur du sous-sol, ou le stockage saisonnier dans un très grand accumulateur d’eau). Ce "capteur hybride" permet de produire à la fois de l’électricité et de la chaleur avec une surface plus compacte que si on utilisait ces deux types de capteurs sur un même toit. En hiver et en entre-saison, la performance de la partie thermique est moins bonne que celle d’un capteur thermique classique. Mais en été, le fait que la température soit plus basse devient un avantage pour éviter la surchauffe de l’installation – surtout si la chaleur solaire est conduite par des sondes géothermiques pour réchauffer le sous-sol (refroidi durant l’hiver pour chauffer le bâtiment). En effet, une température trop haute peut modifier l’entourage des sondes et réduire les bons échanges de chaleur avec le terrain. S’ils offrent en théorie beaucoup d’avantages, les panneaux hybrides doivent encore faire leur preuve sur la durée.
Panneau solaire hybride "photovoltaïque-thermique" : un panneau solaire photovoltaïque a une production optimale d’électricité lorsque sa température est à environ 20°C. Or, il s’échauffe sous le soleil et perd de son efficacité. D’où l’idée de l’associer à un capteur solaire thermique non vitré: sous les cellules photovoltaïques est disposé un circuit d’eau qui récupère la chaleur (qui peut être utilisée pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, la régénération de la chaleur du sous-sol, ou le stockage saisonnier dans un très grand accumulateur d’eau). Ce "capteur hybride" permet de produire à la fois de l’électricité et de la chaleur avec une surface plus compacte que si on utilisait ces deux types de capteurs sur un même toit. En hiver et en entre-saison, la performance de la partie thermique est moins bonne que celle d’un capteur thermique classique. Mais en été, le fait que la température soit plus basse devient un avantage pour éviter la surchauffe de l’installation – surtout si la chaleur solaire est conduite par des sondes géothermiques pour réchauffer le sous-sol (refroidi durant l’hiver pour chauffer le bâtiment). En effet, une température trop haute peut modifier l’entourage des sondes et réduire les bons échanges de chaleur avec le terrain. S’ils offrent en théorie beaucoup d’avantages, les panneaux hybrides doivent encore faire leur preuve sur la durée.
La performance d’une installation photovoltaïque ne dépend pas uniquement de la qualité des cellules solaires. L’appareillage électrique et le schéma de câblage sont aussi très importants. Par exemple, lorsqu’un panneau reçoit de l’ombre (celle d’une cheminée, par exemple), la performance de tous les panneaux branchés en série diminue. Les panneaux récents contiennent des diodes by-pass ou un optimiseur de puissance pour contourner ce problème. Il peuvent aussi être équipés d'un micro-onduleur sous chaque panneau solaire: ils fonctionnent ainsi comme branchés en parallèle, et la défaillance (ou l'ombrage) d'un panneau n'influence pas la performance des autres.
Bâtiment isolé

Électrifier un bâtiment qui n’est pas relié au réseau public
Les panneaux photovoltaïques permettent d’électrifier un bâtiment qui n’est pas raccordé à un réseau électrique public (maison isolée, chalet, cabane). Dans ce cas, on peut choisir la forme de l’électricité que délivrent les prises. Si on opte pour du courant continu 12 ou 24 volts (tel que le produisent les panneaux solaires), il n’y a pas besoin d’onduleur. Ce système à l’avantage de provoquer moins de pertes d’énergie, mais il faut acquérir des appareils spéciaux qui fonctionnent sur 12 ou 24 volts (voir dans les équipement pour bateaux ou caravanes). Si on opte pour le courant alternatif 230 volts (le standard de nos prises), il faut un onduleur qui convertit le courant continu en courant alternatif et qui élève la tension. L’installation est plus chère à mettre en place, mais elle offre davantage de souplesse, notamment parce qu’on peut utiliser les appareils électriques ordinaires qui sont souvent moins chers.
Dans tous les cas, il faut prévoir des batteries et un boîtier qui règle leur charge (chargeur). Ce sont des éléments très important pour une installation solaire autonome et ils peuvent représenter plus de la moitié de son coût sur le long terme. Les batteries et le chargeur doivent être choisis en rapport avec la puissance des panneaux. Ainsi, pour dimensionner une installation solaire autonome, il faut d’abord faire l’inventaire des appareils que l’on prévoit d’utiliser (lampes, frigo, ordinateur etc.) et totaliser l’énergie qu’ils utiliseraient pendant plusieurs jours sans soleil, en fonctionnant uniquement sur les batteries. Comme il existe de nombreux modèles de batteries et de panneaux solaires, il vaut mieux passer par un spécialiste pour faire le choix, ou acquérir un kit complet (panneaux photovoltaïques, connexions, chargeur, batteries).
Les batteries contiennent des substances malvenues dans l’environnement. Lorsqu’elles arrivent en fin de vie, on a le devoir de les remettre dans une déchèterie officielle ou dans un commerce spécialisé.
Subventions
Aides financières pour les installations photovoltaïques
En mai 2017, le peuple suisse a adopté la Loi sur l'énergie qui permettra de mettre en place la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération. Depuis le 1er janvier 2018, c'est la fondation Pronovo (une "filiale" de Swissgrid, la société nationale qui possède et exploite le réseau électrique suisse à très haute tension) qui gère les aides financières pour l'achat et la mise en place des installations photovoltaïques, et pour rétribuer le courant solaire injecté dans le réseau électrique. En résumé, il y a désormais deux systèmes d'encouragement financier:
- Le SRI (Système de Rétribution à l'Injection), c'est le rachat du courant solaire produit.
- La RU (Rétribution Unique), qui est une aide financière à l'investissement. Elle se divise en PRU (Petite Rétribution Unique) pour les installations de moins de 100 kWc, en GRU (Grande Rétribution Unique) pour les installations supérieures ou égales à 100 kWc, et en RUE (rétributions uniques élevées), pour les installations photovoltaïques de 2kW à 149.99 kW sans consommation propre.
Pour que Pronovo puisse prendre en compte une installation, il faut lui adresser l’avis de mise en service complet émis par le distributeur d’électricité auquel l’installation est raccordée.
Pour les installations solaires mises en service avant 2018, consulter les informations et le module "tarificateur" sur le site de Pronovo.
Il y a parfois des possibilités de recevoir des subventions auprès de certains cantons, communes et fournisseurs d’électricité. Dans presque tous les cantons, les dépenses liées à la mise en place d’une installation solaire sur un bâtiment existant sont déductibles des impôts.
Plug & Play
Petite installation photovoltaïque Plug & Play mobile branchée directement sur une prise électrique
En Suisse, un abonné du réseau électrique est en droit d'installer chez lui une petite installation solaire photovoltaïque mobile, dite "Plug & Play" ou "plug-and-play", d'une puissance maximale de 600 watts et qui s'enfiche directement dans une prise électrique. Avec une installation Plug & Play, le courant solaire est injecté dans le circuit du bâtiment sans passer par un appareillage de contrôle spécial, ni par un compteur (comme c'est le cas pour une installation plus puissante). Cette énergie renouvelable peut alors alimenter les appareils électriques et électroniques en cours de fonctionnement: frigo, modem, chargeur de batteries, pompe de circulation de chauffage, etc. L'électricité qui n'est pas consommée in situ est mise à la disposition du réseau pour les abonnés du voisinage.
Sur l'année, une installation Plug & Play de 500 watts peut produire environ 500 kWh d'électricité, soit un cinquième de ce que consomme un ménage-type de 2 personnes (~2500 kWh par an) – sans compter le chauffage et la production d'eau chaude.
Injection dans le réseau et autoconsommation
En cas de panne du réseau...
Mon installation solaire photovoltaïque produira-t-elle de l'électricité en cas de panne du réseau public (blackout) ?
En cas de panne ou d'interruption du réseau électrique public (blackout), une installation solaire photovoltaïque reliée au réseau est conçue pour se déconnecter automatiquement: elle n'injecte plus d'électricité, ni sur le réseau public, ni dans le bâtiment (installation avec autoconsommation). Il n'y a donc plus d'électricité disponible pour le ménage, ni pour charger les véhicules électriques. Le but de cette déconnexion automatique est d'éviter que les panneaux solaires n'injectent de l'électricité sur le réseau, alors que des personnes y travaillent pour gérer la panne (risque d'électrocution). La déconnexion automatique protège aussi le circuit électrique du bâtiment contre un risque d'incendie.
Pour qu'une installation solaire photovoltaïque puisse continuer à fournir de l'électricité au bâtiment en cas de panne du réseau public, elle doit disposer de batteries de stockage et être dotée d'une fonction "blackout", qui permet de la transformer momentanément en une installation autonome découplée du réseau (off-grid).
Injection dans le réseau électrique
Injecter toute son électricité solaire dans le réseau public
Lorsque l’installation photovoltaïque injecte (on dit aussi "refoule") toute son électricité dans le réseau public auquel le bâtiment est raccordé, on peut la considérer comme une petite centrale solaire indépendante. Les kilowattheures injectés sont comptabilisés par un compteur de production – c’est sur cette base que le propriétaire de l’installation est rétribué par le distributeur local, qui a l’obligation légale de lui racheter son courant. Le prix de rachat varie suivant le distributeur, la taille de l’installation et le fait qu’elle soit ou non bénéficiaire d'un système de rétribution.
Dès 2026, le tarif de rachat sera le même pour toute la Suisse, et sera calculé à la fin de chaque trimestre, en fonction du prix du marché "équivalent photovoltaïque" des mois précédents. Le tarif de rachat sera donc à priori plus bas en été, quand l'énergie photovoltaïque est abondante, et plus haut en hiver, quand elle est plus rare. Un tarif de rachat plancher sera toutefois établi pour assurer une rétribution minimale même si le prix du marché descend plus bas. Ce tarif plancher sera différent pour les petites installations jusqu'à 30 kW, comme les villas, et les installations plus conséquentes.
Pour ses propres besoins en électricité, le bâtiment possède un compteur ordinaire, et il est un client "normal" du réseau. Bien que "consommation" et "production" soient séparées sur le plan comptable, dans la réalité les électrons suivent le plus court chemin vers les appareils et les lampes: le bâtiment consomme aussi sa propre électricité.

Disposé pour être vu par les élèves, ce compteur d’électricité solaire affiche la production des panneaux photovoltaïque situés sur le toit de leur école.
Autoconsommation
Consommer sa propre électricité (autoconsommation)
La loi sur l’énergie et l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité précisent que le propriétaire d’une installation photovoltaïque n’est pas obligé d’injecter toute l’électricité produite dans le réseau. Lorsqu’un bâtiment "autoconsomme" une partie de son électricité solaire (au lieu de l’injecter entièrement dans le réseau public), il est équipé d’un dispositif de régulation et de comptage un peu plus complexe, et donc un peu plus cher à installer. L’avantage de l’autoconsommation, c’est qu’elle incite le propriétaire à adapter l’usage de ses appareils électriques (notamment de chauffage et de production d’eau chaude) à son rythme de production.
Comme vu plus haut, un ménage standard peut couvrir sa consommation annuelle d’électricité (sans compter le chauffage, ni la production d’eau chaude) avec une installation photovoltaïque de 4 kWc. Cependant, l’ensoleillement n’est souvent pas en phase avec ses besoins: les panneaux ne donnent pas d’électricité pendant la nuit, et ils en produisent 4 à 5 fois moins en décembre-janvier qu’en juin-juillet. Or, c’est en hiver et en soirée qu’on a le plus besoin d’électricité pour s’éclairer, cuisiner et faire fonctionner les appareils. Ainsi, seul environ un tiers de l’électricité fournie par les panneaux est généralement directement utilisé, les deux autres tiers étant injecté dans le réseau public.
La part d’autoconsommation d’un bâtiment peut augmenter si on l’équipe aussi de batteries de stockage. Le marché propose des batteries au lithium de nouvelle génération, grandes comme un frigo et capable de stocker assez d’énergie (~10 kWh) pour apporter une autonomie de plusieurs jours. Leur durée de vie est annoncée à plus de 10 ans. Pour un stockage plus important, il existe une solution encore expérimentale: utiliser l’électricité solaire en excès pour produire de l’hydrogène à partir de l’eau (par électrolyse). L’hydrogène, gaz explosif et inflammable, est stocké dans des bonbonnes. En cas de besoin, il est conduit dans une pile à combustibles qui produit à la fois de l’électricité et de la chaleur.
Dans tous les cas, on gagne à coordonner l’usage des consommateurs d’électricité avec la production solaire: machines à laver le linge et la vaisselle, recharge d’accus pour les appareils et les véhicules électriques, etc. Si le chauffage et la production d’eau chaude se font avec une pompe à chaleur, on peut augmenter la part d’autoconsommation avec une programmation qui tient compte de la météo et des plages de production d’électricité solaire (optimiseur).
Autoconsommation et batteries de stockage, sur le site de SuisseEnergie
Communauté d'autoconsommateurs
Vendre l'électricité solaire aux voisins
Depuis 2018, il est possible de former une communauté d'autoconsommateurs entre habitants d'un même immeuble ou entre habitants de maisons individuelles voisines. Le but est de partager l’électricité solaire produite par l'installation photovoltaïque d'un membre (ou de plusieurs membres) de la communauté, afin d'augmenter la part d'autoconsommation. La communauté d'autoconsommateurs est représentée par un gestionnaire et par un seul compteur d'électricité: c'est un client unique auprès du distributeur d'électricité. Mais chaque membre de la communauté a aussi son propre compteur pour procéder à la facturation interne, en fonction de la consommation de chacun. Il existe plusieurs modèles pour la mise en place d'une communautés d'autoconsommateurs, dont le gestionnaire peut être un propriétaire, une coopérative solaire ou même le distributeur local d’électricité.
Communauté d'autoconsommateurs, sur le site de SuisseEnergie
Chauffage, eau chaude et climatisation
Produire de l’eau chaude
Produire de l’eau chaude avec un chauffe-eau "pompe à chaleur"
Pour produire de l’eau chaude au robinet (eau chaude sanitaire), on connaît depuis plus de 40 ans les capteurs solaires thermiques: ils s’échauffent sous le soleil, et leur chaleur passe dans un circuit d’eau et d’antigel qui les relient à un chauffe-eau. Il leur faut juste un peu d’électricité pour faire tourner la pompe de circulation. Le rendement est faible durant les jours froids et couverts, mais il peut-être très élevé durant la période estivale (plus de 80%) – au point que la production de chaleur excède souvent largement les besoins en eau chaude et peu conduire à une surchauffe de l’installation.
Même si leur rendement ne dépasse pas 20%, les panneaux solaires photovoltaïques peuvent produire de l’eau chaude avec un bon rendement, s’ils sont associés à un chauffe-eau pompe à chaleur (CEPAC). Un CEPAC (appelé aussi chauffe-eau thermodynamique) peut produire de l’eau chaude avec 2 à 3 fois moins d’électricité qu’un chauffe-eau électrique classique (désormais déconseillé ou interdit dans les constructions neuves dans la plupart des cantons). Cet appareil soutire la chaleur de l’air d’une cave ou d’un garage et rejette de l’air plus froid.
Au lieu de panneaux photovoltaïques, on peut aussi associer des capteurs solaires thermiques à un CEPAC. Des études ont montré que, compte tenu du mix électrique suisse, le bilan des deux solutions est à peu près équivalent sur le plan environnemental.
Touchez les icônes en bas de l’image


Panneaux photovoltaïques, chaudière et CEPAC
Ce bâtiment est équipé de panneaux solaires photovoltaïques. Il est chauffé par une chaudière à combustible (bois, gaz ou mazout), et son eau chaude sanitaire est produite par un chauffe-eau pompe à chaleur (CEPAC) qui fonctionne à l’électricité.
En hiver, sous le soleil

Le bâtiment consomme l’électricité de ses panneaux solaires pour produire de l’eau chaude, pour faire fonctionner les appareils électroménagers et électroniques, et pour recharger les batteries (ordinateur, téléphone, vélo électrique etc.). Lorsque le besoin en électricité dépasse la capacité de production de ses panneaux, il recourt à l’électricité du réseau – ce qui arrive plus souvent en hiver qu’en été.
En hiver, de nuit

Toute l’électricité consommée provient du réseau. Le CEPAC est réglé pour ne pas fonctionner durant les heures sans soleil (la réserve d’eau chaude produite durant la journée suffit). On évite aussi de mettre en marche les appareils qui peuvent fonctionner durant la journée (lave-linge) ou de recharger les accus.
En été, sous le soleil

La chaudière est complètement éteinte. L’eau chaude sanitaire est produite grâce à l’électricité solaire. Le bâtiment optimise sa consommation de courant en faisant fonctionner ses appareils tour à tour, afin de ne pas devoir recourir à l’électricité du réseau. Le supplément d’électricité solaire est injecté dans le réseau, et revendu à un tarif fixé par le distributeur local.
En été, par jour nuageux

La production d’électricité a lieu même par ciel couvert. Mais comme elle ne suffit pas toujours au bâtiment, il doit consommer de l’électricité du réseau. Le bâtiment peut optimiser sa consommation d’électricité en organisant l’usage de certains appareils en fonction de l’ensoleillement et des prévisions météorologiques.
Chauffer avec le soleil
Chauffage et eau chaude avec des panneaux solaires
Comme déjà mentionné, la part d’autoconsommation d’électricité solaire peut être maximale lorsque le bâtiment est équipé d’une pompe à chaleur (qui fonctionne avec de l’électricité) pour le chauffage et l’eau chaude – à condition de coordonner le fonctionnement de la pompe à chaleur avec l’ensoleillement. Pour faire des réserves de chaleur au moment où le soleil est le plus actif, il faut que l’installation comporte un grand accumulateur d’eau et une régulation électronique qui anticipe l’ensoleillement et les besoins du bâtiment. Le but est, par exemple, d’éviter que la pompe à chaleur fonctionne juste après les douches du matin (7h30) pour refaire le stock d’eau chaude sanitaire – en utilisant l’électricité du réseau – alors qu’elle pourrait profiter de l’électricité gratuite des panneaux photovoltaïques si elle attendait 10h.
Lorsqu’on parle de bâtiment "zéro énergie", cela ne veut pas forcément dire qu’il soit autonome en énergie. Dans le cas du label Minergie A, le bâtiment produit – sur l’année – au moins autant d’énergie qu’il en consomme. Mais il a besoin d’un apport d’énergie lorsque le soleil ne suffit pas à alimenter ses capteurs solaires – par exemple un poêle à bois et de l’électricité du réseau. En hiver, l’autonomie est difficile à atteindre, alors qu’en été les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques produisent souvent de la chaleur et de l’électricité en excès par rapport aux besoins.
En Suisse, quelques bâtiments exemplaires parviennent à se chauffer de manière autonome en combinant à la fois des panneaux solaires photovoltaïques et des capteurs solaires thermiques avec un très grand volume de stockage de chaleur (par exemple un accumulateur d’eau chaude de 200’000 litres pour 8 appartements). D’autres utilisent des capteurs hybrides phtotovoltaïques-thermiques, une pompe à chaleur "sol-eau" (c’est-à-dire couplée à des sondes géothermiques) et un stockage saisonnier de la chaleur dans le sol: la chaleur solaire inutilisée durant la belle saison est conduite en profondeur par les sondes géothermiques pour régénérer la chaleur du terrain soutirée en hiver. Cette chaleur est ensuite récupérée par la même installation durant la saison de chauffage.
Touchez les icônes en bas de l’image
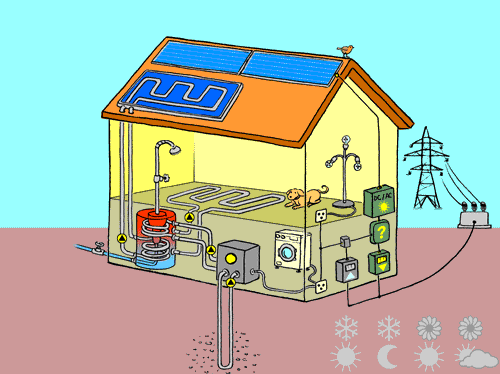
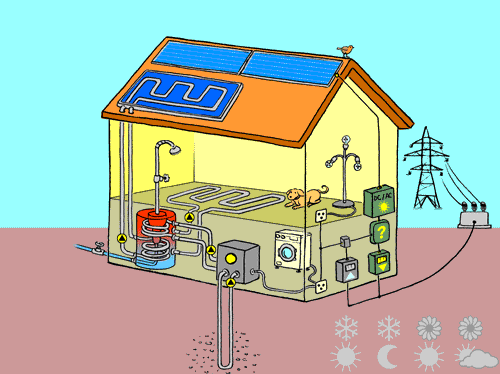
Panneaux photovoltaïques et capteurs thermiques avec une pompe à chaleur "sol-eau"
Ce bâtiment est équipés de deux type de panneaux solaires: producteur d’électricité (photovoltaïque) et collecteur de chaleur (thermiques). Pour son chauffage et la production d’eau chaude sanitaire, il utilise une pompe à chaleur "sol-eau".
En hiver, sous le soleil
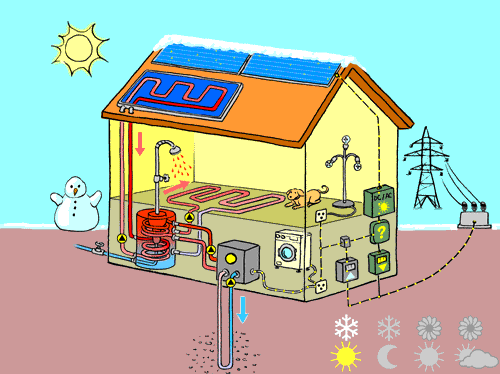
Les panneaux solaires délivrent de la chaleur et de l’électricité. Mais pas assez pour rendre le bâtiment autonome en énergie: il doit régulièrement importer de l’électricité du réseau. La pompe à chaleur soutire des calories du sous-sol, ce qui permet de monter la température du stock d’eau chaude qui sert au chauffage (par le sol) et à la préparation de l’eau chaude sanitaire.
En hiver, de nuit

Pour faire fonctionner son éclairage et ses appareils électriques et électroniques, le bâtiment importe de l’électricité du réseau. Si le stock d’eau chaude constitué durant le jour ne suffit pas à son chauffage, il doit aussi faire tourner sa pompe à chaleur.
En été, par jour de soleil

La pompe à chaleur ne fonctionne pas, car le capteur thermique produit largement assez de chaleur pour produire de l’eau chaude sanitaire. Le supplément de chaleur est envoyé dans le circuit de la sonde géothermique, afin de réchauffer le sous-sol qui a été refroidi durant l’hiver. Les pompes de circulation utilisent peu d’électricité, si bien que le bâtiment peut injecter une grande partie de son électricité solaire dans le réseau.
En été, par jour nuageux

La pompe à chaleur n’a pas besoin de fonctionner, car le stock d’eau chaude est assez volumineux pour permettre de tenir plusieurs jours sans soleil. Le lave-linge et le lave-vaisselle sont branchés sur l’eau chaude solaire et utilisent ainsi moins d’électricité. Le bâtiment revend au réseau une grande partie de son électricité solaire.
Rafraîchir le bâtiment
Rafraîchir les locaux en été
Avec le réchauffement climatique et ses canicules attendues plus fréquemment, la surchauffe des locaux en milieu urbain est un vrai défi énergétique. Utiliser l’électricité de panneaux photovoltaïques pour faire fonctionner des climatiseurs traditionnels n’est pas la bonne solution, puisque ces appareils utilisent beaucoup d’électricité et produisent au total davantage de chaleur dans les rues que de froid à l’intérieur des bâtiments (faible efficacité). Le free-cooling est une solution plus élégante qui consiste à pomper directement la fraîcheur du sol ou de l’eau (lac, rivière, nappe souterraine), à l’aide de la même installation qui sert à chauffer le bâtiment en hiver (couplage d’une pompe à chaleur avec des sondes géothermiques ou un circuit d’eau). Le serpentin de chauffage au sol, utilisé en hiver, peut ainsi conduire de l’eau froide durant l’été. Le free-cooling utilise peu d’électricité puisque c’est uniquement la pompe de circulation qui fonctionne, sans l’usage du compresseur de la pompe à chaleur. Il n’y a donc pas de rejets de chaleur à l’extérieur du bâtiment, comme c’est le cas avec la climatisation conventionnelle.
Bilan environnemental des panneaux solaires photovoltaïques
Nuisances
Électrosmog et bruit
Toute installation et tout appareil électrique en fonction émet de l’électrosmog, autrement dit du rayonnement électromagnétique. Les panneaux solaires et le câblage produisent du courant continu qui émet moins de rayonnement que les dispositifs à courant alternatif. Si on habite directement sous le toit sur lequel se trouvent les capteurs, l’exposition est faible (très en dessous des normes) et disparaît complètement pendant la nuit, lorsque les panneaux ne produisent plus d’électricité. Dans une installation photovoltaïque qui injecte son électricité dans le réseau, c’est l’onduleur qui est susceptible d’émettre le plus d’électrosmog. Un onduleur sans transformateur en émet davantage qu’un onduleur dit "à séparation galvanique". Selon le principe de précaution, on évitera de le placer à quelques mètres d’un lieu où l’on séjourne (ni juste de l’autre côté du mur, car l’électrosmog passe à travers les murs). Une autre bonne raison de mettre l’onduleur à distance, c’est qu’il produit généralement du bruit lorsqu’il fonctionne: grésillement électrique et (souvent) ventilateur de refroidissement. Le bruit, qui disparaît pendant la nuit, peut être dérangeant pour les êtres humains et les animaux domestiques.
L'électrosmog des installations photovoltaïques, sur le site de l'Office fédéral de l'environnement
Environnement & recyclage
Recyclage et bilan environnemental des panneaux solaires photovoltaïques
Si on compare son électricité avec celle du réseau (mix électrique), un panneau photovoltaïque génère sur l’ensemble de son cycle de vie – qui peut durer plus de 20 ans – bien moins de gaz à effet de serre. Au niveau de l’énergie grise, un panneau récent rembourse ce qui a été investi dans sa fabrication en 2 à 4 ans. La fabrication des panneaux en couches minces demande moins d’énergie et produit moins de gaz à effet de serre que celle des panneaux en silicium (qui sont plus massifs).
Au niveau des ressources également, les panneaux photovoltaïques font mieux que l’électricité du réseau. Cependant, les modèles en couches minces utilisent des minéraux rares dont certains éléments sont dangereux une fois libérés dans l’environnement (cadmium, sélénium, plomb). Et le procédé de fabrication des modèles en silicium utilise des gaz fluorés qui détruisent la couche d’ozone.
Arrivés en fin de vie, les panneaux photovoltaïques sont considérés comme des déchets électroniques qui doivent suivre une filière spéciale. En Europe, les normes sur leur traitement sont encore en élaboration. En Suisse, ils sont soumis à une obligation de restitution (par le propriétaire) et de reprise (par le commerçant), comme le sont déjà les appareils électriques et électroniques. Il faut savoir que les cellules, démontées de leur cadre métallique et débarrassées de leur câblage, doivent êtres transportées intactes et avec précaution vers les usines de recyclage: elles peuvent continuer à produire de l’électricité si elles sont exposées au soleil, et il faut pouvoir les trier en fonction de leur composition. Les récupérateurs doivent éviter de les casser et de les broyer pour ne pas disperser des poussières irritantes ou toxiques.
L'essentiel à retenir
Des panneaux solaires photovoltaïques sont au bon endroit :
- Dans toutes les situations géographiques, en plaine comme en altitude (où le rayonnement solaire est plus intense). Et n’importe où: sur un pan de toit, sur un toit plat, en remplacement d’une partie de la couverture du toit, sous un balcon ou devant (en remplacement de la balustrade), en façade, sur un garage, sur un talus, dans un jardin... pourvu que les panneaux puissent recevoir directement le soleil. Les orientations les plus favorables sont entre le Sud-Est et le Sud-Ouest. Quand on s’écarte davantage du Sud, le rendement baisse, mais il est encore possible d’aller jusqu’à l’Est et l’Ouest. L’inclinaison des capteurs sur la hauteur détermine leur performance au cours de la saison. Si on cherche la performance hivernale, ils doivent regarder idéalement le Sud/Sud-Ouest, être dressés entre 45 et 60°, et éviter l’accumulation de neige.
- Sur n’importe quel bâtiment, même s’il n’est pas bien isolé. Cependant, pour le même coût qu’une installation solaire, des travaux d’isolation réalisés selon les normes apportent une économie d’énergie souvent plus grande.
- Si une autorisation a été accordée (elle n’est pas nécessaire dans tous les cantons). Elle peut être refusée pour des raisons de sauvegarde du patrimoine ou du paysage. Pour les installations de plus de 30 kVA, un plan doit être présenté à l’ESTI (Inspection fédérale des installations à courant fort).
- Si le distributeur électrique local est prêt à en racheter le courant (sauf s’il s’agit d’un bâtiment isolé du réseau).
- Si l’installation est mise en place par un spécialiste autorisé à travailler sur le réseau électrique.
- Si les panneaux solaires sont munis d’une certification reconnue.
- Si les panneaux sont équipés pour le problème d'ombrage et de défaillance possible. Si les panneaux sont branchés en série, la défaillance ou l'ombrage d'un seul panneau limite la performance des autres. Ce problème peut être surmonté avec des panneaux équipés de diodes by-pass, d'optimiseurs de puissance ou d'un micro-onduleur pour chaque panneau.
- Si le dessous des panneaux est aéré pour éviter des pertes de rendement à cause de la chaleur.
- Si on ne laisse pas la poussière, les feuilles mortes et les crottes d’oiseaux s’accumuler sur les panneaux (la pluie fait une bonne partie du nettoyage).
- Si on pense aussi à économiser l’électricité et à gérer sa consommation pour profiter au maximum de l’électricité solaire (autoconsommation).
Liens utiles
"Mon installation solaire en 7 étapes" de SuisseEnergie • Une aide pour toutes les étapes nécessaires à concevoir, deviser, réaliser et financer une installation solaire
Calculateur-solaire de SuisseEnergie
Fiche d'information de SuisseEnergie ENCOURAGEMENT DES INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES: RÉTRIBUTION UNIQUE, PRIME DE MARCHÉ FLOTTANTE ET BONUS
SWISSOLAR • Association suisse des professionnels de l’énergie solaire
pronovo • Fondation issue de Swissgrid, gestionnaire des subventions SRI et RU
vese • Cette association regroupe les coopératives solaires suisses, ainsi que les propriétaires professionels et privés d’installations solaires indépendants
Carte par commune de Suisse de développement des panneaux solaires • Où en est votre commune?