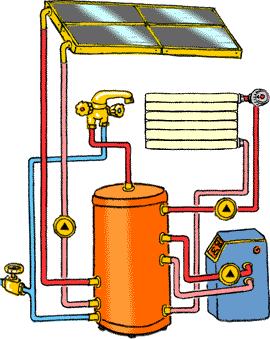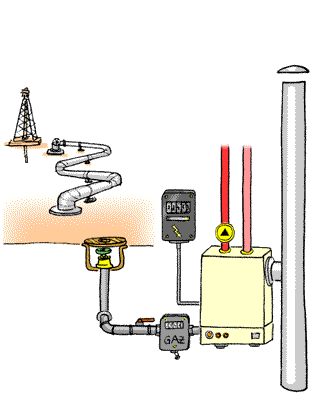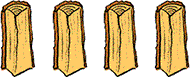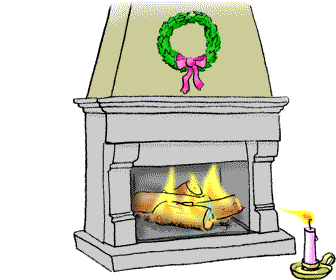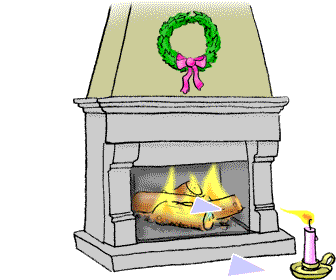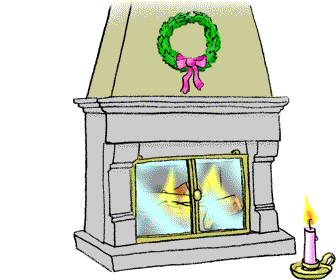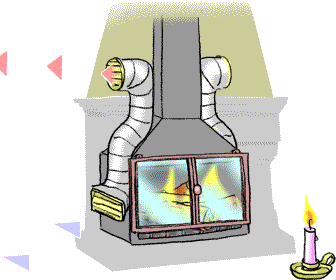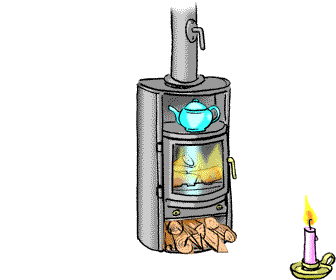Le bois, c'est de l'énergie solaire en conserve. En effet, un arbre fabrique son bois en utilisant la lumière du soleil pour combiner le CO2 de l'air avec l'eau et les sels minéraux du sol. Lorsqu'on brûle du bois, l'énergie solaire est libérée. La combustion reforme du CO2, de la vapeur d'eau et des sels minéraux (les cendres). La fumée contient aussi des oxydes d'azotes (NOx) et d'autres polluants de l'air dont les concentrations dépendent de la qualité du bois et de l'installation de chauffage.
Pour la problématique du réchauffement climatique, se servir du bois pour chauffer des bâtiments dans une région est pleinement justifié, pour autant que la masse des arbres de la région ne diminue pas: le CO2 dégagé par la combustion du bois est réabsorbé par les arbres en croissance...

En Suisse, le bois de chauffage est une énergie disponible localement, et la gestion des forêts et du paysage permet de garantir son statut d'énergie renouvelable. De plus, le bois favorise l’indépendance énergétique du pays, tout en offrant de nombreuses activités liées à l'entretien des arbres, à leur abattage et leur débitage, à la construction de bâtiments et de meubles, et à la production de combustible pour le chauffage: les bûches, les plaquettes (petits morceaux de bois déchiqueté) et les pellets – des granulés de sciure compressée du diamètre d'un crayon (voir photo).

 Touchez l’image pour l’animer
Touchez l’image pour l’animer
Une chaudière automatique à pellets (ou plaquettes de bois) se charge grâce à une vis sans fin. Comme toute chaudière automatique, elle a aussi besoin d’électricité.
Poêle, chaudière automatique, centrale de chauffage à distance...
Il existe des installations de chauffage au bois très variées et de toute taille. Les plus simples sont les poêles à bûches qui se chargent et s'allument manuellement. Étant donné qu'ils fonctionnent sans électricité, ils offrent une grande sécurité de chauffage. Il existe aussi des poêles à pellets qui fonctionnent sans électricité et qui peuvent chauffer pendant 2-3 jours sans recharge. Les poêles de masse (en pierre ou en céramique) ont une plus grande inertie, ce qui permet une diffusion de la chaleur prolongée une fois que le feu est éteint. Installé dans un séjour ouvert sur le reste du logement, un tel poêle suffit pour chauffer toute une maison familiale (ou un appartement) qui a de faibles besoins de chaleur.
Le poêle automatique à pellets nécessite un raccordement électrique. L'allumage et la combustion sont gérés électroniquement. Il trouve sa place dans le séjour et fonctionne plusieurs jours automatiquement sans recharge. Certains modèles de poêle à bûches ou à pellets peuvent même être reliés à un circuit de radiateurs ou de chauffage au sol, et produire également de l’eau chaude sanitaire.
D’un fonctionnement comparable à une chaudière à mazout, la chaudière automatique à pellets s’installe dans une chaufferie, à côté d’une réserve de pellets qui prend entre 2 et 3 fois la place d'une citerne à mazout. C'est souvent la meilleure solution pour remplacer une installation au mazout dans un bâtiment qui ne peut pas être suffisamment isolé, et dont la température de départ (température de l'eau du circuit de chauffage) est élevée. La réserve de pellets peut trouver sa place dans le local de l'ancienne citerne qui a été évacuée.
Une chaudière automatique à pellets est généralement plus coûteuse qu'une installation similaire au mazout, mais elle peut bénéficier d'aides financières. Les cantons de Fribourg et de Neuchâtel, ainsi que la Confédération, ont mis en ligne un calculateur qui compare les coûts de plusieurs solutions de chauffage, en tenant compte des subventions cantonales:
Comparatif des coûts de chauffage (Fribourg) -www.fr.ch
Comparatif des coûts de chauffage (Neuchâtel) -www.ne.ch/energie
Chauffez renouvelable (SuisseEnergie) -www.chauffezrenouvelable.ch
Les chaudières automatiques de grande taille, qui alimentent de grands bâtiments ou des réseaux de chauffage à distance (CAD) utilisent généralement du bois déchiqueté (plaquettes). La Suisse compte ainsi plus de 1000 réseaux de chauffage à distance alimentés par du bois. Ils desservent notamment des centres scolaires ou des quartiers de bâtiments. Une installation centralisée dotée d’une bonne combustion et d’un système d’épuration des fumées est plus efficace et moins polluante qu’une multitude de petites installations à bois.
Quand le bois brûle mal, la flamme peut émettre des polluants nocifs pour la santé
Une chaudière automatique à pellets qui répond aux normes actuelles émet dans l'air environ 100 fois moins de particules fines qu'une vieille chaudière à bûches. En effet, si la combustion est incomplète, la flamme produit des COV (composés organiques volatils), de la suie ou du goudron qui est particulièrement nocif. La suie se forme lorsque l'oxygène manque, tandis que le goudron se forme par excès d’oxygène. Plus la combustion est incomplète, et plus la flamme dégage une fumée polluante – souvent très visible et odorante.
Pour les chaudières automatiques destinées aux maisons individuelles ou aux petits immeubles, une bonne combustion est plus facile à atteindre avec des pellets qu'avec des plaquettes. En effet, étant donné que la chaudière fonctionne par intermittence, la chambre de combustion se refroidit avant le redémarrage. Or, les pellets sont plus faciles à doser et s'enflamment mieux que les plaquettes. Pour les grandes installations qui fonctionnent en régime quasi-continu, une bonne combustion est possible avec des pellets, des plaquettes et même des bûches.
C'est justement pour éviter des cycles extinction/allumage trop fréquents de la chaudière qu'il est nécessaire d'adjoindre à l'installation une grande réserve d'eau chaude (ballon-tampon) dans laquelle le chauffage central va puiser la chaleur à la demande.

Les fourneaux et les poêles alimentés par des bûches peuvent également obtenir une bonne combustion s'ils possèdent un foyer "à flamme inversée". Mais l'allumage du feu reste toujours une source importante de pollution, car le foyer est froid et la température de la flamme n'est pas assez élevée. Pour limiter la production de fumée au départ du feu, la bonne pratique consiste à allumer le feu par dessus.
Fumée sous contrôle
Un contrôle périodique des émissions de polluants atmosphériques est obligatoire pour tous les chauffages centraux alimentés au bois, y compris pour ceux dont la puissance calorifique est inférieure à 70 kW. Une installation bien réglée, régulièrement entretenue et brûlant un combustible de qualité, respecte généralement les valeurs limites d'émissions. Toutefois, dans certains cas, l'ajout d'un filtre à particules – voire le changement de l'installation – s'avère nécessaire.
Les cheminées de salon ouvertes émettent beaucoup de pollution pour peu d'efficacité
Parce que la quantité d’air qui arrive sur les flammes ne peut pas être contrôlée, les cheminées de salon dites "à foyer ouvert" sont particulièrement polluantes et ont un mauvais rendement: moins de 10% de l’énergie du bois est utilisée, contre plus de 80% dans un bon poêle ou une cheminée fermée moderne. De plus, le foyer ouvert aspire fortement l’air du logement (entre 300 et 500 m3 par heure): faire du feu lorsque le chauffage central fonctionne gaspille beaucoup d’énergie. Il est possible d’assainir une cheminée existante en y intégrant un insert en fonte ou en acier.
Chaleureux, mais peu de chaleur
Comme chauffage d’appoint, une cheminée classique dite "à foyer ouvert" n’est vraiment pas l’idéal! Même la plus parfaite des cheminées tire beaucoup trop d’air pour contribuer à chauffer efficacement le logement.
Rendement: 5% ou moins !
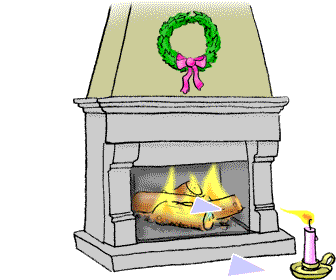
Comme la température de combustion des bûches est basse, l’énergie du bois n’est utilisée qu’en très faible partie: 5% au mieux. Et les émissions polluantes sont importantes.
De plus, une très grande quantité d’air du logement est aspirée avant d’être évacuée vers le ciel: entre 300 et 500 m3 par heure. En hiver, c’est de l’air chauffé qui est ainsi perdu. Il est remplacé par de l’air froid qui s’insinue par les interstices des fenêtres et à travers les murs.
Rendement: autour de 20%
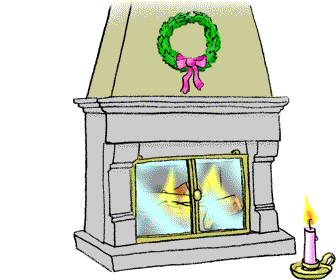
Des portes en vitrocéramique ont été ajoutées: si elles sont montées hermétiquement et permettent de régler l’entrée d’air dans le foyer, elles réduisent l’échappement d’air à environ 50 m3 par heure. Elles favorisent aussi une meilleure combustion du bois. Néanmoins, la cheminée ne dégage pas encore assez de chaleur pour servir efficacement de chauffage d’appoint.
Rendement: 60% ou davantage
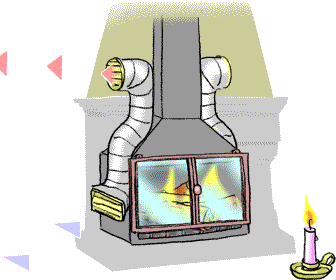
La cheminée a reçu un insert chauffant, une sorte de foyer intérieur en fonte ou en acier, qui permet à la fois de régler la quantité d’air entrant dans le foyer et de récupérer une partie de la chaleur. L’air ambiant est aspiré, chauffé au contact de l’insert, puis redistribué dans la pièce. Il existe de nombreux modèles différents, dont certains avec ventilateur électrique dont le rendement peut atteindre 80%.
L’idéal est d'amener de l'air dans le foyer à l'aide d'un conduit relié directement à l'extérieur.
Rendement: autour de 80%
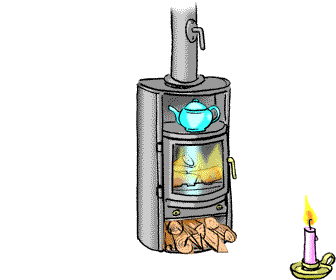
La vieille cheminée a fait place à un poêle suédois branché sur le même conduit d’évacuation. Le rendement peut dépasser 80%. Si on préfère un look "cheminée", il existe des modèles performants (mais plus chers qu’un poêle suédois): la "cheminée à air chaud" ou la "cheminée à accumulation" (environ 80% de rendement).
Les poêles à accumulation en pierre ollaire ou en céramique chauffent moins rapidement une pièce, mais leur chaleur est diffusée plus longtemps (rendement pouvant dépasser 80%). Il existe aussi des poêles automatiques à granulés de bois, à charger seulement tous les 2 ou 3 jours.
Fermer le clapet de tirage

Lorsqu’il n’y a pas de feu dans la cheminée, ne pas oublier de fermer le clapet de tirage de la cheminée, afin d’empêcher l’air chauffé du logement de s’échapper (ou l’air froid de descendre depuis le toit, si la cheminée a un mauvais tirage).
Le bois de récupération doit être brûlé uniquement dans des installations spéciales
Le bois de chauffage (bûches, pellets et plaquettes) coûte environ 4 fois moins cher que le bois de construction. C’est la raison pour laquelle il provient surtout d’arbres dont le bois a peu de valeur, de déchets de l’entretien et de l’exploitation des forêts, des taillis et des jardins, ainsi que des déchets de scierie et de menuiserie (copeaux et sciure). Quant au bois utilisable en construction, il est écologiquement souhaitable de l’utiliser comme matériau dans un premier temps, et de le récupérer après usage pour le brûler dans un second temps (utilisation en cascade). Cependant, en raison des traitements chimiques qu’il a pu subir et de la contamination par d’autres produits ou matériaux, le bois de récupération doit être brûlé uniquement en usine d’incinération des ordures ménagères (UIOM), ou dans une chaudière autorisée et équipée d’un système d’épuration des fumées.
Le bois et la biomasse issue de l’exploitation des forêts et de l'entretien du paysage peuvent aussi être transformés en biogaz, en gaz d’une qualité similaire à celle du gaz "naturel" (le gaz d'origine fossile), ou en alcool. Des centrales CCF existent déjà (elles produisent de l'électricité et de la chaleur) qui démontrent qu’il est possible de tirer davantage d’énergie de nos arbres, tout en réduisant drastiquement les émissions polluantes, si la réflexion sur le chauffage se déroule à l’échelle d’une commune ou d’une région.
Le potentiel énergétique du bois n'est pas totalement exploité
En Suisse, on brûle chaque année plus de 5 millions de m3 de bois, soit environ 10% de l’énergie utilisée pour le chauffage des bâtiments. Le potentiel de production de bois du pays n’est pas encore exploité et pourrait augmenter encore de moitié sans nuire au paysage et aux forêts. Avec le réchauffement climatique, beaucoup d'arbres souffrent et dépérissent à cause des sécheresses, des canicules et des insectes ravageurs. Dans ce contexte, les professionnels du bois pensent qu'une plus forte exploitation des forêts permettrait de replanter des arbres d'espèces plus résistantes, afin de maintenir le patrimoine forestier.
Une chaudière automatique à bois est au bon endroit :
- Si ce chauffage est en accord avec la planification énergétique territoriale. En zone urbaine, en raison de la qualité déjà critique de l’air, un chauffage à bois n’est pas toujours souhaitable, surtout si le bâtiment peut se contenter d’un chauffage à basse température et utiliser une pompe à chaleur.
- Si le bois (bûches, plaquettes, pellets) est suffisamment sec (pellets de qualité certifiée), et ne nécessite pas de transport sur une très longue distance.
- Si l’installation possède un certificat de conformité, ainsi qu’un label de qualité ("Minergie" ou "Energie-bois Suisse" pour les petits chauffages»; "QM Chauffages au bois" pour les grandes installations).
- Si l’installation à bûches ou à plaquettes est munie d’un filtre à particules (même s’il n’est pas obligatoire).
- Si l’installateur peut produire une "Garantie de performance" de SuisseEnergie pour les installations jusqu'à 500 kW.
- Si la cheminée est assez haute pour que la fumée ne dérange pas les voisins et que son orifice se situe au-dessus de la partie la plus élevée du bâtiment.
- Si l'installation est équipée d'un accumulateur de chaleur (ballon d'eau chaude) d'une capacité suffisante (obligation légale de l'OPair).
- Si on peut éteindre la chaudière hors de la saison de chauffage, et produire l’eau chaude sanitaire avec des capteurs solaires thermiques ou une pompe à chaleur (chauffe-eau thermodynamique).
- Si les conduites qui passent dans des locaux non chauffés sont bien isolées, et si les pompes de circulation de l’eau de chauffage sont efficaces (classe A).
- Si les radiateurs sont équipés de vannes thermostatiques.
- Si, en cas de remplacement d'une chaudière, on vérifie que la distribution de chaleur dans le circuit hydraulique est bien équilibrée.
- Si on ne laisse pas le chauffe-eau s’entartrer.
- Si l’installation est régulièrement suivie, et si la chaudière et la cheminée sont inspectées selon la réglementation.
- Si les cendres sont éliminées correctement: ordures ménagères pour les petites quantités, ou décharge. En raison de leur concentration en métaux lourds (d’origine naturelle ou issus des outils de scierie), les cendres ne doivent pas être utilisées dans le jardin. Elles peuvent notamment contenir du chrome(VI) un métal lourd qu'il est dangereux de respirer (cancérigène).
Une cheminée ou un poêle à bois est au bon endroit :
- Si elle/il peut servir de chauffage d’appoint.
- Si elle/il possède un label Minergie ou Energie-bois Suisse.
- Si l’air qui alimente le foyer provient de l’extérieur du bâtiment.
- Si la cheminée est assez haute pour que la fumée ne dérange pas les voisins.
- Si la cheminée est munie d’un filtre à particules (même s’il n’est pas obligatoire).
- Si on y brûle uniquement du bois sec, non traité et tempéré, en procédant à l’allumage par dessus pour éviter la production de poussières fines (fumée).
www.energie-bois.ch, Association Energie-bois Suisse
 ConsoBat • Ce calculateur gratuit permet de suivre la consommation d'énergie du chauffage en fonction de la météo. Il détecte rapidement les anomalies de consommation, et permet de mesurer les économies d'énergie dues à des travaux de rénovation (ou à de nouveaux réglages de l'installation de chauffage) indépendamment de la météo.
ConsoBat • Ce calculateur gratuit permet de suivre la consommation d'énergie du chauffage en fonction de la météo. Il détecte rapidement les anomalies de consommation, et permet de mesurer les économies d'énergie dues à des travaux de rénovation (ou à de nouveaux réglages de l'installation de chauffage) indépendamment de la météo.





![]() pdf 2,8 Mo- Les règles d'or de l'énergie solaire thermique, document de SuisseEnergie
pdf 2,8 Mo- Les règles d'or de l'énergie solaire thermique, document de SuisseEnergie![]() pdf 3,9 Mo- Le solaire thermique en Suisse et le potentiel du DrainBack, rapport du LESBAT, 2018
pdf 3,9 Mo- Le solaire thermique en Suisse et le potentiel du DrainBack, rapport du LESBAT, 2018